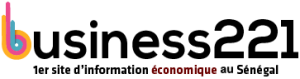Partagé entre protectionnistes et partisans du libre-échange, le continent se trouve à un tournant en matière de doctrine économique. Mais que gagnerait véritablement l’Afrique à davantage s’intégrer commercialement ?
En refusant de signer le traité de Kigali le 19 mars dernier qui ouvrait la voie à la création d’une vaste zone de libre échange continentale (ZLEC), le président nigérian, Muhammadu Buhari, a-t-il cédé à la pression interne de la seconde plus grande économie africaine au détriment d’une ambition d’intégration commerciale continentale ? L’on est en droit de se poser la question, tant le rétropédalage nigérian semble avoir marqué les esprits, à un moment où les 54 nations africaines semblaient enfin sur la voie de faire converger leurs efforts pour réduire le déficit d’intégration qui mine les échanges entre eux.
Il faut dire que pour Buhari, le choix semblait cornélien. D’un côté, il prenait le risque de mécontenter les puissants syndicats du Nigéria qui réclamaient d’être partie prenante de la négociation, et qui craignent plus que tout une ouverture non maîtrisée qui fragiliserait davantage un tissu industriel déjà essoufflé par la chute des cours du pétrole. De l’autre, le président du Nigéria risquait de se mettre à dos ses pairs chefs d’Etats, qui ont travaillé d’arrache-pied sous l’égide de l’Union africaine à poser les jalons de la plus vaste zone de libre échange au monde depuis la création de l’OMC. Forte de 54 pays, 1,2 milliard de consommateurs, la ZLEC s’inscrivait dans l’agenda 2063 de l’UA, visant à créer une Afrique « intégrée, prospère et pacifique ». Porté notamment par le président Rwandais Paul Kagamé, ainsi que par l’ancien patron de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, l’initiative avait tout sur le papier pour séduire, et répondait à une urgence.
En premier lieu, le continent africain assiste à un élargissement de la fracture en matière d’intégration économique et commerciale entre sa partie anglophone et francophone. En juin 2015, la partie orientale du continent franchissait en effet un pas décisif avec la signature à Charm el-Cheikh d’un accord de libre-échange ouvrant la voie à un vaste marché commun unissant vingt-six pays, « du Caire au Cap ». Cette Zone tripartite de libre-échange (TFTA), qui avait nécessité cinq années de négociations, est le fruit de la fusion de trois organisations régionales : la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), et le Marché commun des états d’Afrique australe et de l’Est (COMESA). La Tripartite inclut près de la moitié des pays et de la population du Continent, constituant la plus grande zone de libre-échange africaine jamais mise en place.
Or, elle souligne encore plus les profondes lignes de fracture qui traversent le Continent. Avec la création d’une grande dorsale économique orientale à dominante anglophone, certains observateurs craignaient ainsi la résurgence d’une « logique de blocs » près de trente ans après la fin de la Guerre froide.
Une Afrique à deux vitesses ?
Opposée à la façade atlantique et francophone de l’Afrique – qui souffre encore de fragmentation chronique – la nouvelle zone économique intégrée faisait courir le risque de l’émergence d’une économie africaine à deux vitesses, avec toutes les tensions potentielles que cela implique. À l’Est, le mot d’ordre serait donc fluidité et libre circulation des hommes et des marchandises. À l’Ouest, si les barrières ne tombent qu’au compte-gouttes, elles pourraient générer un effet d’éviction des talents et des capitaux en faveur de la Tripartite.
Et c’est précisément pour éviter ce « choc des verticales » que l’Union africaine s’est investie dans le dossier de la création d’une vaste zone de libre-échange continentale, avec la conviction que l’ouverture serait, à terme, plus bénéfique que la poursuite de la politique des « petits pas » en matière d’intégration. Pour autant, le texte élaboré par l’Union africaine ne constituait pas un « grand soir » en matière d’intégration commerciale, et était sujet non seulement à ratification par les nations membres de l’UA, mais également à une progressivité de l’ouverture en fonction des intérêts vitaux des pays qui composent l’Union.
D’où l’incompréhension globalement suscitée par l’attitude du Nigéria. Comment, à un moment aussi crucial pour un continent aux prises avec de multiples crises, ne pas opter pour la « voie de l’aveni r» que pourrait offrir plus de libre-échange au sein de l’Afrique ?
La réponse à cette question et l’attitude qu’adoptera l’Union Africaine après le Sommet de Kigali seront cruciales en matière de posture économique du Continent, et font de l’Afrique un véritable laboratoire de test des doctrines économiques tant le chemin de la convergence semble parsemé d’embûches et de concessions faites aux agendas politiques internes au détriment d’une prospérité partagée.
Les balances commerciales sont des résultats, pas des causes
A cet égard, la lecture du dernier rapport du Global Future Council on International Trade and Investment du Forum économique mondial, consacré aux « Idées fausses autour des balances commerciales », constitue un document de référence dont l’on devrait conseiller la lecture à tous ceux qui seraient tentés par le repli protectionniste. En effet, ce rapport balaie l’ensemble des arguments généralement mis en avant pour freiner le libre-échange, que l’on retrouve en bonne place dans le champ sémantique utilisé pour freiner la ZLEC.
Parmi ces derniers, l’on retiendra que la tentative de substituer la production locale aux importations en taxant ces dernières est non seulement vaine, mais elle favorise de manière mécanique l’augmentation de la contrebande, réduisant d’autant les recettes douanière et fiscales d’Etats aux budgets déjà fortement déséquilibrés. Autre « serpent de mer » régulièrement invoqué, le déficit des balances commerciales occasionnerait des pertes d’emploi massives. Or, l’analyse des données macro-économiques sur les temps longs battent en brèche cette vision des choses. En effet, les balances commerciales peuvent s’aggraver lors de périodes de forte croissance, comme c’est actuellement le cas au Ghana où l’augmentation de la demande est tirée par le boom économique, favorisant non seulement les importations, mais l’activité économique de manière générale.
Des économies plus inclusives à construire
De manière globale, ce rapport insiste sur la nécessité de construire des économies beaucoup plus inclusives, au lieu de se cantonner à tenter d’écoper l’eau avec un seau percé. En effet, il est nécessaire de bien comprendre que dans les économies modernes, les balances commerciales sont les résultats de politiques économiques et non les causes. D’où l’importance pour l’Afrique de construire une vision du libre-échange qui permette à la fois de protéger les économies les plus fragiles, mais également de libérer pleinement le potentiel du commerce intra-africain, alors même que le Continent est actuellement la zone la moins intégrée au monde.
Bien entendu, la construction de cette Afrique mieux intégrée, plus agile et plus efficace nécessite que le politique remplisse pleinement son rôle et pose avec acuité la question du rôle de la gouvernance. En effet, les réflexes protectionnistes se nourrissent également de la tentation de préserver certains avantages acquis, souvent dévolus à des écosystèmes dopés par la rente et incapables de s’en départir. Ces derniers trouveront toujours des arguments aux atours rhétoriques apparemment viables et aux relents nationalistes pour refuser la compétition économique. De manière claire, cela signifie que le chantier de la transparence des affaires, de la réforme de la justice commerciale et de la restauration de la confiance en l’avenir doit être mis au premier plan afin que l’ouverture commerciale maîtrisée, prônée par l’Union africaine, ait des chances de réussir.
(Source : https://afrique.latribune.fr/)