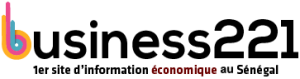Dans la décharge de Mbeubeuss, les travailleurs sont sur la défensive quand ils entendent prononcer le mot « violence ». Longtemps considéré comme le lieu par excellence de la délinquance, les femmes et les hommes qui y travaillent ont fini par enlever cette étiquette en essayant d’évoluer dans un cadre plus ou moins formel. Mais, la décharge n’est pas épargnée par les violences et les femmes en sont les premières cibles. Des violences qu’elles ont décidé de subir en silence dans un milieu où la discrétion, l’omerta sont de rigueur.
Sur l’esplanade de Mbeubeuss, un mouvement brusque attire toutes les attentions. Un camion est en train de déverser les déchets récupérés dans différentes artères de Dakar. Un groupe d’hommes de tout âge se rue vers le véhicule cherchant à tirer la meilleure partie de cette cargaison. Coup d’épaule, croche-pieds, tous les moyens sont bons pour « se servir ». Parmi cette foule, une mince silhouette qui tente tant bien que mal de se frayer un chemin, reçoit un violent coup d’épaule qui manqua de la faire tomber. Il s’agit d’une femme. Une femme comme Aïcha, Racky, Fatou Diallo, Diaba Diouf, et tant d’autres.
Elles ont une chose en commun. Elles sont toutes victimes de violences morales parce qu’elles travaillent dans la décharge de Mbeubeuss. Si certaines personnes comme Aïssatou Ndiaye, une jeune femme d’une trentaine d’années, arrivent à comprendre que les femmes qui travaillent ici, gagnent honnêtement leur vie. D’autres comme Khady Ba, vendeuse ou Aliou Ndiaye, un menuisier désapprouvent le fait que des femmes fréquentent Mbeubeuss pour travailler ou pour d’autres activités.
« Je n’aimerais pas savoir qu’un de mes proches travaille dans la décharge de Mbeubeuss, tout le monde dit que c’est un lieu fréquenté par les délinquants », a laissé entendre Khady Ba.
C’est le genre de commentaire que ces femmes présentes à la décharge essuient quotidiennement de la part de leurs proches ou voisinage. Fatoumata Ba, appelé Aïcha par ses collègues, souffre dans sa chair. « Souvent je passe la nuit à pleurer, je n’ai personne à qui me confier pour me soulager », laisse-t-elle entendre, avec émotion
Il y a un peu plus de deux ans, Aïcha travaillait comme receveur dans les bus Tata (bus interurbain). Veuve et mère de trois enfants, elle se reconvertit à la décharge de Mbeubeuss quand elle a perdu son travail. Actuellement, secrétaire générale de la section des femmes de « Bokk Diom », l’association qui réunit l’ensemble des travailleurs de Mbeubeuss, elle, comme plusieurs de ses collègues, nettoient les objets récupérés, un travail qui lui permet d’avoir un gain journalier pour subvenir aux besoins de sa famille.
« On relève la tête… »
Sous une vaste tente, couverte de zing pour les protéger du soleil, une cinquantaine de femmes s’y affairent. Chacune d’entre elles récupère la cargaison qu’elle doit nettoyer ce jour. Aïcha Ba comme l’appelle les intimes, en vraie leader, définit les tâches avant de s’installer pour commencer le travail. A l’aise dans ses tâches, cela ne semble pas être le cas une fois rentrée chez elle. Cette quiétude, la déserte dès qu’elle rentre le soir. Dans son entourage Mme Ba est victime du mépris de ses proches.
Comme Aïcha, Seynabou Badji, travaille à Mbeubeuss. Contrairement à sa collègue, Seynabou a préféré cacher à ses proches qu’elle travaille dans la décharge. C’est, dit-elle : « pour protéger mes enfants, ma famille de manière générale ». Seynabou a travaillé pendant 13 ans dans un hôtel de la place. Elle a débord bossé à la lingerie avant d’être serveuse au sein du même établissement. Mais hélas, cette mère de famille perd son travail du jour au lendemain et cela fait quatre ans qu’elle gagne sa vie dans la décharge pour entretenir sa famille, son époux étant absent du pays. Seynabou Badji ne veut pas que ses proches soit au courant du travail qu’elle fait parce ce qu’elle ne veut pas être marginalisée. « J’aurais préféré dire tout haut et avec fierté que je gagne dignement ma vie dans la décharge mais du moment que les gens sachent que tu travailles dans la décharge surtout quand c’est une femme on te traite de prostitué ou une personne vivant dans une extrême pauvreté au point de vivre avec les ordures », se désole-t-elle. Pour elle c’est une souffrance de devoir mentir à sa famille mais elle n’a pas le choix.
« J’aimerais avoir un meilleur boulot pour échapper à cette inquiétude que quelqu’un de mon entourage découvre que je travaille ici ; mais pour l’instant je me contente de ce que je fais en prenant toutes les précautions. Même mes enfants ignorent complètement que je les nourris grâce à ce travail dans la décharge », confie-t-elle.
Diaba Diouf, une jeune femme, la vingtaine environ, mère d’une petite fille se trouve dans la même situation. Obligée de travailler pour soutenir son mari, la jeune maman a dû cacher à certains membres de sa famille qu’elle gagne sa vie dans la décharge de Mbeubeuss.
« Tous mes proches ne savent pas parce que je ne veux pas qu’ils me jugent », dit-elle. Pourtant très fière de son travail, cette situation est difficile à vivre pour elle. « J’aurais aimé que tout le monde sache que je gagne dignement ma vie mais travailler à Mbeubeuss signifie pour les autres qu’on est des prostituées ou des délinquantes. Et cela nous fait souffrir intérieurement. Cependant je remercie Dieu parce que je ne vole pas pour vivre ».
Fatou Diallo, une quinquagénaire, a dû se replier dans le nettoyage d’objets récupérés pour être en sécurité. Auparavant, elle travaillait au niveau de la plateforme comme récupératrice. Même si elle reconnait que son ancien travail lui rapportait plus, Fatou a préféré se mettre en sécurité parce que, confie-t-elle, les femmes sont très exposées au niveau de la plateforme. « Il faut vraiment être costaud pour travailler là-bas parce que chacun est là pour son propre compte. Quand les camions déversent les ordures c’est la ruée, on ne distingue pas les hommes des femmes », témoigne-t-elle.
Pour Fatou Diallo, les violences physiques sont monnaie courante à Mbeubeuss. Si ce n’est pas au sein de la décharge c’est aux abords, en chemin qu’on est souvent victime d’agression. Toutefois, assure-t-elle, c’est rare d’entendre parler de viol. « Depuis cinq ans que je suis là je n’ai jamais entendu parler de viol », affirme-t-elle comme la plupart de ses collègues.
Une souffrance passée sous silence
Le constat est que dans la décharge de Mbeubeuss, les violences sexuelles sont mises sous silence. Les femmes n’en parlent quasiment pas. Ceci, pour éviter d’attirer l’attention. C’est l’avis de Maguette Diop, le coordonnateur local du projet de réduction des déchets piloté par Wiego dans le cadre du programme Dakar Focal City. Wiego est un organisme qui collabore avec les travailleurs de l’informel pour les aider à se formaliser. Selon le coordonnateur : « souvent c’est dans les séminaires que ces femmes récupératrices libèrent la parole ».
D’après leurs confessions, nous dit-il, elles subissent très souvent des violences physiques. « Si ce ne sont des gestes d’intimidation liés directement au travail, (parce qu’au niveau de la plateforme, où s’effectue le tri des déchets, c’est chacun pour soi et c’est la loi du plus fort qui y règne) ; ce sont des attouchements sexuels », a indiqué M. Diop. Souvent témoigne-t-il ce sont leurs collègues qui en sont les auteurs parce qu’il n’existe aucun dispositif sécuritaire pour ces femmes. « Celles qui ont une certaine force physique et morale ainsi qu’un fort caractère sont les seules qui arrivent à se préserver de ces agressions », renseigne Maguette Diop.
Celui-ci va plus loin : « quand les femmes viennent intégrer la décharge, elles sont sous la responsabilité d’hommes qui se disent être leur tuteur. Celui-ci est sensé prendre la femme sous son aile afin de la protéger mais cela finit souvent par des abus sexuels que personne ne dénonce ».
Ces femmes, pour éviter les invectives préfèrent taire leurs souffrances plutôt que de se plaindre aux autorités ou réclamer justice.
En effet soutient Maguette Diop, les femmes ne viennent jamais vers eux pour demander de l’aide à propos de ces cas d’agressions dont elles sont victimes. « C’est en parlant de leurs conditions de travail qu’elles nous font toutes ces révélations. Elles disent souvent que si leur environnement de travail est amélioré, il y aurait moins de violences à leur égard », raconte-t-il.
La décharge où plus de 1500 personnes gagnent leur vie est dépourvue de toilettes. Il n’est pas rare d’apercevoir, au détour d’une montagne de déchet, une personne faire ses besoins en plein air. Ce genre de situation expose les femmes, à en croire Abdoul Aziz Diallo, plus connu sous le pseudonyme Bankhass, président de l’association des récupératrices et récupérateurs de Mbeubeuss, « Bokk Diom ».
Selon lui, à la décharge, les cas de violences physiques ou d’abus sexuels sont souvent étouffés car les différents protagonistes s’arrangent à ce que cela soit réglé en interne. Souvent sollicité dans ces cas-là, Bankhass joue au médiateur.
D’après lui, les violences sexuelles sont monnaie courante dans leur milieu. « Je suis souvent interpellé quand il y a un cas d’agression avéré. Pour la plupart du temps on essaie de régler les choses à l’interne. Mais il arrive que cela dégénère et que l’affaire atterrisse à la police », confie-t-il. Il y a quelques temps, raconte Bankhass, une femme récupératrice a été sauvagement violée par un homme qui vit au fond de la plateforme de la décharge.
« Celui que tout le monde prend pour un fou a menacé la dame à la machette avant d’abuser d’elle. Mais alertés des récupérateurs qui n’étaient pas très loin de la scène ont interpelé l’auteur des faits qui été ensuite remis à la police. Mais quelques temps après on l’a vu roder par ici », narre-t-il. Ce cas est l’une des rares qui ont atterri devant la police mais, selon Bankhass, la plupart des cas d’agressions même sexuelles sont réglés au sein de la décharge même. Parce que, soutient-il : « souvent les protagonistes sont tous des récupérateurs travaillant ici. Et pour la plupart du temps, ce sont des scènes de ménage, des crises de jalousies entre collègues qui se terminent par des viols ou des coups et blessures ».
Violences au quotidien…
Pour Bankhass les femmes vivent au quotidien des violences de quelques natures que ce soit. « Elles sont menacées et si quelqu’un ose dénoncer c’est la catastrophe. Il n’est pas rare de voir quelqu’un menacer des pensionnaires de la décharge avec une machette », avoue-t-il.
Pape Ndiaye, un des doyens de la décharge confirme les confessions du président de l’association en soutenant qu’il ne se passe pas deux semaines sans que la police ne fasse une décente dans la décharge pour arrêter les délinquants. « Mais, il nous est arrivé d’arrêter nous-mêmes un violeur pris sur le fait et nous l’avons délivré à la police ». Pour Pape Ndiaye, les cas de viol sont rares dans la décharge mais au-delà de la souffrance morale, les femmes sont souvent victimes de violence physique.
Environnement propice à la violence…
Mariane Ndiaye, juriste membre de l’AJS, affirme que de manière générale, les boutiques de droits ne reçoivent pas spécifiquement de plaintes provenant des femmes travailleuses de la décharge. « Nous assistons les femmes en ce qui concerne les cas de violences physiques, conjugales ou économique mais nous ne sommes jamais intervenues dans la décharge », confie-t-elle. Selon la juriste, ces femmes ont tendances à taire les violences dont elles sont victime. « C’est peut-être pour échapper au jugement du public qu’elles ne se dévoilent pas », estime-t-elle. Selon elle il serait intéressant d’avoir des données concernant ces femmes parce qu’il faut reconnaitre que leur environnement est propice à la violence.
Embouchant la même trompette, la commissaire de police de Malika assure que depuis son installation en février 2019, on ne lui a pas fait cas de violence concernant une femme au niveau de Mbeubeuss. Mais reconnait-elle : « c’est une zone de refuge des délinquants et elle représente un défi sécuritaire pour nous ».
La prévention pour parer…aux violences
Pour relever ce défi, la commissaire et son équipe ont mis en place un dispositif pour contenir les agresseurs. « Nous misons sur la prévention en mettant en place des check-points avec des éléments qui veillent à la porte de la décharge et cela dissuade les plus téméraires », explique-t-elle. A l’en croire, cette stratégie donne des résultats satisfaisants.
Toutefois, malgré leur silence, les femmes travailleuses à Mbeubeuss auraient préféré que les autorités s’occupent de ces cas de violences. « Cela pourrait dissuader les délinquants », a laissé entendre Seynabou Badji
Dans la même lancée Diaba Diouf soutient : « pour notre sécurité les auteurs des violences physiques doivent être punis sinon ils risquent de récidiver ».
Néanmoins, à leur niveau, le coordonnateur de Wiego, déclare que son organisme est en train de réfléchir pour mettre en place des stratégies pour davantage protéger ces femmes. Surtout améliorer leurs conditions de travail en écartant les violences, en installant des garderies pour leurs enfants, des toilettes, mais aussi la mise en place des coopératives. Les former sur le genre et le droit afin qu’elles puissent faire face à certaines situations aussi, fait partie des ambitions.
ENCADRE
Des chiffres de Mbeubeuss
D’après une étude de base portant sur les récupérateurs de déchets en relation avec le système formel de gestion à Dakar, réalisée en 2018 par le Laboratoire de Géographie Humaine (LaboGéHu) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les femmes représentent un peu plus du quart des 1584 récupérateurs recensés à Mbeubeuss soit 26%. Cette étude a aussi montré que les agressions physiques sont le premier danger ressenti sur le site (32, 14%). Dans les mêmes proportions, un peu moins du tiers des récupérateurs (29%) ont ressenti un danger dans les interactions sociales avec des personnes à Mbeubeuss. Ces violences affectent plus d’une femme sur 5 soit 20,7%.
Mêmes si plusieurs d’entre elles reconnaissent être bien traitées par leurs collègues de travail, elles sont souvent victimes de violences.
Dieynaba TANDIANG ( Source : Direct-Info)